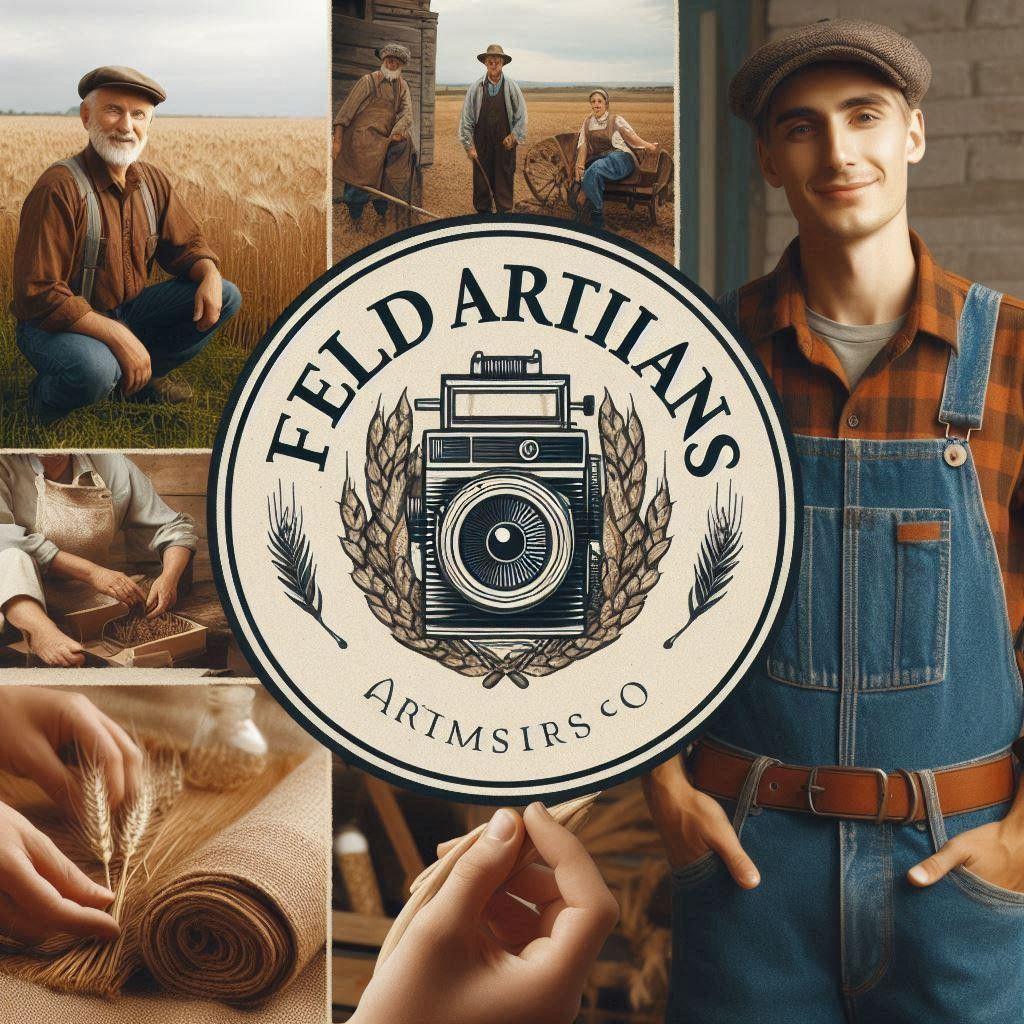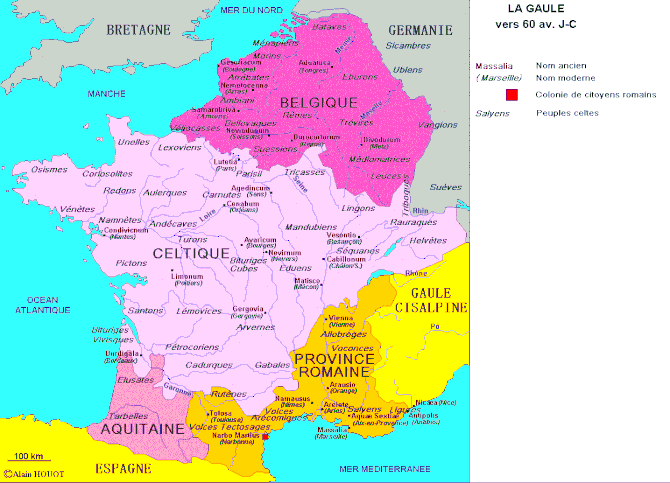La Gaule transalpine
Le temps de la Conquête
"En s'avançant vers le nord de la Gaulle, on ne rencontre plus de plantations d'oliviers,ni de figuiers,ni de vigne....En revanche tout le reste de la Gaulle produit du blé en grande quantité ainsi que du millet,des glandset du bétail de toute éspèce;le sol n'y demeure nulle part en friche,si ce n'est dans les parties où les marécages et les bois interdisent toute culture,Encore ces régions, sont -elles habitées comme les autres:mais cela tient non pas tant à l'industrie des Gaulois qu'à une vraie surabondance de la population,car les femmes sont d'une fécondité remarquable et d'excellentes nourrices.Quant aux hommes,ils ont toujours été,en fait plus guerriers qu'agriculteurs.Maintenant qu'ils ont déposé les armes, les voici cependant forcés de cultiver la terre....Presque tous les Gaulois, encore aujourd'hui couchent sur la dure et prennent leurs repas assis sur de la paille.Ils se nourrissent de lait, de viandes diverses,mais surtout du porc frais ou salé... la grande quantité de bétail,surtout de moutons et de porcs qu'ils possèdent explique comment ils peuvent approvisionner si abondamment de vêtements et de salaisons non seulement Rome,mais l'Italie."
Strabon
La création des Gaules est une longue histoire dont les images sont souvent loin de la réalité et des hommes qui l'on tissé. Mais on sait aujourd'hui que trés tôt , la construction d'un espace hexagonal se confond avec l'invention continue des paysages par les hommes.
Depuis le "décollage" du néolithique la mise en forme des espaces n'a céssé de se faire dans la riche diversité des terroirs,des productions,des techniques dans la pluralité des cultures et des populations mêlées.Ainsi nulle part "nos ancêtres" n'étaient tous gaulois,ni ces "barbares" impies querelleurs fleaux des peuples civilisés, dont les Romains ont banalisé l'image dans une Gaule aux forêts complices.
Guerriers, et paysans,aristocrates ou gens du peuple ont eu villages,villes, demeures rurales, divinités protrecrtices,sanctuaires, et druides.Ils ont pensé le monde, et mesurer le temps forger des Etats,échangé,frappé monnaie Le combat des chefs attiraient tant d'étrangers,tels les Grecs et les Romains.
La Gaule n'est donc pas née de Rome,mais l'ordre impérial vainqueurs des résistances,l'a remodelée.Le quadrillage des campagnes,l'ordre des villes et des villae,l'école en latin,le droit romain,les divinités séduites et reconverties ont permis cohabitation,exploitation et développement.Une nouvelle civilisation homogène a vu le jour.
Dans nos villes,nos noms de lieux,nos chemins ruraux s'entrelacent les traces plurielles de cette mémoire millénaire.Car,l'empire vaincu,Rome eternelle est réstée, et les notables reclassés en grands abbés et puissants évêques, ont entamé la longue croisade de la christianisation de" Gaule rebarbarisée".
Le temps
des
conquêtes
La conquête de la Gaule constitue un évènement capitale pour l'histoire du pays.Elle s'opère en deux étapes:à la fin du IIeme siècle avant J C les Romains occupent la Gaule méridionale;un peu plus de soixante dix ans plus tard avec Jules César ils annexent toute la Gaule.
Dans l'ensemble des campagnes gauloises,ils utilisent les même méthodes de domination.Ils pratiquent à la fois la violence la plus grande afin d'établir leur autorité,et la diplomatie la plus conciliante pour la maintenir.Ils sont en effet conscients que leurs intérêts résident dans l'exploitation du pays et non dans sa destruction ni dans l'extermination de la population.
Aussi tentent ils de s'appuyer sur les classes dirigeantes indigènes qui doivent leur servir de relai et qu'ils s'attachent par divers dons.Si elles résistent,ce que font Vercingétorix et les siens, la riposte est féroce.
Celtes et Romains se connaissent depuis longtemps.Attirés par les richesses du pays etrusque,des bandes celtiques s'étaient installées dans le nord de la pénincule italienne au IVeme siecle av J-.C.S'infiltrant jusqu'à Rome et pillèrent la ville;nous sommes en 360 av J-C
La conquête s'opère entre 125 et 118 av J.C.L'occasion est fournie par Marseille,qui se disant menacée par les populations voisines appelle Rome à son secours.
Les Romains expédient des légions,qui agissent avec la plus grande éfficacité:ils détruisent Entremont,l'oppidium des Ligures, et installent un camps romain à Aix en Provence.Aprés avoir conquis la Provence,la Vallée du Rhône, et le Languedoc, les Romains fondent en 118 la colonnie de Narbonne qui devient la capitale de la nouvelle Province,La Gaule Transalpine.
Occupation de la Gaule transalpine
Apremière vue la domination romaine en Gaule transalpine paraît légère.La région fut fut sans doute soumise au régime provincial.Dans les oppidiums indigènes la vie continue,certains même se développent et à l'exception d'Entremont,ils ne semblent pas avoir subi les effets d'une guerre de conquête.Les premiers temps de l'occupation sont scandé par des révoltes qui révèlent à la fois le refus de la domination et la haine des provinciaux face aux exactions des Romains et à leurs exigences fiscales.
La création de la colonie de Narbonne s'accompagne d'expropriations de terres indigènes et leurs impôts sont si lourds que les Gaulois sont contraints d'emprunter de l'argent à des taux usuraires aux seuls banquiers romains.En outre corvés et taxes sont laissé à l'arbitraire des gouverneurs comme en témoigne l'exemple de Fonteius.ce gouverneur de la Gaule Transalpine entre 74 et 72 av J.C est connu par le discours que Cicéron prononça pour le défendre dans un proçés intenté par les Gaulois éxaspérés par ses agissements:taxzes sur les vins,exemptions de corvées, corruptions généralisée.
Marcus Fonteius
Il a gouverné la Gaule transalpine comme préteur pendant trois ans, vraisemblablement dans les années 70 av. J.-C., l’opinion la plus fréquente penchant pour la période 74-72. En 69, son procès s’ouvre à Rome pour divers faits de concussion qui lui sont reprochés par les Gaulois, et notamment par une délégation conduite par Indutiomare, chef des Allobroges.
Son défenseur est Cicéron
. Le procès arrive devant le tribunal des repetundae. Dans les arguments en faveur de son client, Cicéron n’hésite pas à défendre d’emblée la légitimité de l’action de Fonteius, la situant dans le cadre de la colonisation. Dans ces conditions, l’examen du détail des charges pesant contre lui (malversations à l’occasion de réquisitions, profits sur la réparation des routes, sur les droits sur le vin, violences à l’occasion de la guerre des Voconces et de l’organisation des camps d’hiver de l’armée) se trouve amoindri. La Gaule méridionale que décrit Cicéron est une province agitée et l’orateur semble dire qu’il ne faut pas juger Fonteius comme s’il était un gouverneur administrant une province en temps de paix, mais un chef de guerre conduisant la politique coloniale de Rome.
Provinciae Galliae M. Fonteius praefuit, quae constat ex iis generibus hominum et civitatum qui, ut vetera mittam, partim nostra memoria bella cum populo Romano acerba ac diuturna gesserunt, partim modo ab nostris imperatoribus subacti, modo bello domiti, modo triumphis ac monumentis notati, modo ab senatu agris urbibusque multati sunt, partim qui cum ipso M. Fonteio ferrum ac manus contulerunt, multoque eius sudore ac labore sub populi Romani imperium dicionemque ceciderunt.
La province de Gaule, que Fonteius a gouvernée, comprend des peuples et des cités de diverses sortes : plusieurs — pour ne rien dire des siècles passés — ont, de notre temps, mené contre le peuple romain des guerres longues et acharnées ; plusieurs ont été soumis par nos généraux ou domptés par nos armes ou flétris par nos triomphes et des monuments de leur défaite, ou encore condamnés par le Sénat à être dépossédés de terres et de villes. D’autres ont combattu contre M. Fonteius lui-même qui, à grand’peine et à grand effort, les a fait tomber sous la domination du peuple romain.
Qui erant hostes, subegit ; qui proxime fuerant, eos ex iis agris quibus erant multati decedere coegit ; ceteris qui idcirco magnis saepe erant bellis superati ut semper populo Romano parerent, magnos equitatus ad ea bella quae tum in toto orbe terrarum a populo Romano gerebantur, magnas pecunias ad eorum stipendium, maximum frumenti numerum as Hispaniense bellum tolerandum imperavit.
Ceux qui étaient ennemis déclarés, il les a soumis. Ceux qui l’avaient été peu de temps auparavant, il les a contraints à abandonner les terres dont le Sénat les avait dépossédés. Quant aux autres que des guerres considérables et répétées avaient mis pour toujours dans l’obéissance du peuple romain, il en a exigé une nombreuse cavalerie pour les guerres que le peuple romain menait alors dans l’univers entier, de grosses sommes d’argent pour la solde de ces troupes, une grande quantité de blé pour soutenir la guerre d’Espagne.
Dicunt contra quibus inuitissimis imperatum est, dicunt qui ex agri ex Cn. Pompei decreto decedere sunt coacti, dicunt qui ex bello caede et fuga nunc primum audent contra M. Fonteium inermem consistere. Quid coloni Narbonenses ? Quid volunt, quid existimant ? Hunc incolumen per vos volunt ; se per hunc existimant esse. Quid Massiliensium civitas ? hunc praesentem iis adfecit honoribus quos habuit amplissimos ; vos autem absens orat atque obsecrat, ut sua religio, laudatio, auctoritas, aliquid apud vestros animos momenti habuisse videatur. (15) Quid ? civium Romanorum quae voluntas est ? Nemo est ex tanto numero quin hunc optime de provincia, de imperio, de sociis et civibus meritum esse arbitretur. Quoniam igitur videtis qui oppugnatum M. Fonteium, congostis qui defensum velint, statuite nunc quid vestra aequitas, quid populi Romani dignitas postulet, utrum colonis vestris, negotiatoribus vestris, amicissimis atque antiquissimis sociis et credere et consulere malitis, an iis, quibus neque propter iracundiam fidem, neque propter infidelitatem honorem habere debetis.
Les témoins à charge
sont ceux qui ont obéi avec le plus de répugnance, ce sont ceux qu’un décret de Pompée a contraints à abandonner leurs terres, ce sont ceux qui, après ces années de guerre, de carnage et de fuite, osent pour la première fois affronter M. Fonteius, maintenant qu’il est désarmé. Mais les colons de Narbonne, que veulent-ils, que pensent-ils ? Ils veulent que Fonteius soit sauvé par vous, ils pensent que c’est par lui qu’ils ont été sauvés. Et la ville de Marseille ? Quand il était en Gaule, elle lui a décerné les honneurs les plus grands dont elle disposait. Aujourd’hui, c’est de loin qu’elle vous prie et vous conjure de vouloir bien que sa religieuse reconnaissance, ses rapports élogieux, son crédit aient sur vos esprits quelque pouvoir. (15) Et les citoyens romains, quels sont leurs sentiments ? Il n’en est aucun dans un si grand nombre qui n’estime que Fonteius a rendu les plus grands services à la province, à l’autorité romaine, aux alliés et aux citoyens. Puisque vous voyez quels sont ceux qui s’intéressent à sa défense, prenez maintenant la décision que réclament votre équité, et la dignité du peuple romain. Voyez si vous aimez mieux croire et favoriser vos colons, vos trafiquants, vos alliés les plus dévoués et les plus anciens, ou des peuples qui ne méritent de votre part aucune confiance à cause de leur caractère passionné, ni aucune considération à cause de leur déloyauté.
Les conditions du procès.
L’accusé M. Fonteius (on ignore son cognomen) est un citoyen de Tusculum, chevalier d’origine plébéienne, qui a fait une carrière classique : triumvir monetalis ; questeur urbain à la fin des années 80 ; légat (de légion) en Espagne Ultérieure sous les ordres du préteur C. Annius Luscus ; légat en Macédoine où il arrête une incursion des Thraces ; enfin, trois ans préteur en Gaule, soit de 76 à 74, soit plus vraisemblablement de 74 à 72, où il applique les consignes de fermeté que lui a données Pompée. Il organise l’hivernage des troupes de Pompée en Gaule de 74-73.
Les accusateurs
Il s’agit d’une délégation de Gaulois conduite par le dirigeant des Allobroges, Indutiomare. Il semble qu’il y ait eu unanimité des Gaulois contre Fonteius (Gallorum consensio en VII, 16). Mais seuls les Allobroges, les Volques et les Rutènes sont nommément cités. Pour porter l’accusation, et depuis un réglement sénatorial de 171 av. J.-C., les accusateurs doivent avoir recours à un patronus ; ici, c’est un certain M. Pletorius, et la plainte est contresignée par un certain M. Fabius, sans doute un parent du consul qui avait mené campagne en Gaule contre les Allobroges en 121, ce qui explique certaines allusions de Cicéron dans sa plaidoirie.
Le tribunal
Il s’agit du tribunal apte à juger la quaestio repetundarum (affaire des concussions). Les concussions ou sommes indûment reçues par les magistrats en charge, sont dites repetundae pecuniae, et on juge selon la lex de pecuniis repetundis, loi sur les réclamations des sommes indûment prélevées. Le tribunal, anciennement sénatorial, est devenu mixte depuis une loi de Sylla (sénateurs et chevaliers) et il est placé sous l’autorité d’un préteur. Cette année-là on sait que le préteur M. Metellus était en charge des affaires de concussion.
La procédure
Il s’agit d’une action en répétition, engagée au profit de ceux qui avaient dû donner les sommes incriminées. L’accusation portée devant le peuple par les victimes à la sortie de charge du magistrat fait que le procès ne se limitait pas à une action en droit civil, mais devenait un procès pénal. Le déroulé du procès comportait deux actions successives, la seconde étant déterminante. Le tribunal émettait deux sentences, l’une sur la culpabilité, l’autre sur l’estimation du litige. Le procès eut lieu au début de l’année 69. L’issue est inconnue. On note simplement qu’après cette date, Fonteius n’a plus de carrière publique.On pense que Fonteius « fut vraisemblablement acquitté » .
La défense
Très peu de temps après avoir accusé le gouverneur de Sicile, Verrès, Cicéron prend cette fois la défense d’un autre magistrat accusé à sa sortie de charge, Fonteius. Il semble que ce qui puisse paraître comme une contradiction s’explique par la déférence de Cicéron pour Pompée. En accusant Verrès, Cicéron discréditait les aristocrates et aidait Pompée à détruire la constitution aristocratique de Sylla. En défendant Fonteius, il défendait un instrument de Pompée, placé en Gaule pour assurer la sécurité de la liaison avec Rome, pendant que luimême luttait en Hispania contre Sertorius. Les cités vaincues de Gaule Le tableau que le Pro Fonteio livre de la Gaule méridionale n’est pas celui d’une province pacifiée et régulièrement administrée, mais bien celui d’une province agitée et que l’autorité romaine force à entrer dans son orbite. Autrement dit, si la création de la province de Transalpine date bien de 122-120, elle a dû être assez formelle, administration « floue et lointaine »il est possible qu’il ait fallu attendre la période pompéienne pour que la soumission soit plus fermement obtenue. Dans ces conditions, le rôle de Fonteius a dû être majeur.
Il classe les cités vaincues selon une typologie qui renvoie aux événements préfontéiens ainsi qu’à l’administration de Fonteius. Ce classement implique des situations différentes en droit agraire.
1 - Des cités encore insoumises, vaincues par Fonteius et qui sont entrées dans l’imperium de Rome. C’est le cas des Voconces, puisque les actes de concussion à l’occasion de cette guerre sont un des motifs de l’accusation. C’est encore le cas des Volques.
2 - Des cités vaincues peu auparavant et pour lesquelles Fonteius a mis en œuvre la confiscation des terres décidée par le Sénat. Ici l’allusion concerne la décision de Pompée, en 77 av. J.-C. de concéder des agri des Helviens et des Volques Arécomiques aux Marseillais. Sur ce fait on possède le témoignage de César. 1 Euocat ad se Caesar Massilia XV primos; […]
3 Cuius orationem legati domum referunt atque ex auctoritate haec Caesari renuntiant: intellegere se diuisum esse populum Romanum in partes duas; neque sui iudicii neque suarum esse uirium discernere, utra pars iustiorem habeat causam.
4 Principes uero esse earum partium Cn- Pompeium et C- Caesarem patronos ciuitatis; quorum alter agros Volcarum Arecomicorum et Heluiorum publice iis concesserit, alter bello uictos Sallyas attribuerit uectigaliaque auxerit.
5 Quare paribus eorum beneficiis parem se quoque uoluntatem tribuere debere et neutrum eorum contra alterum iuuare aut urbe aut portibus recipere. [1,35] (1) César mande quinze des principaux Marseillais; […] (3) Les députés reportent ces paroles à leurs concitoyens, et, par leur ordre, reviennent dire à César: "Que voyant le peuple romain divisé en deux partis, ils ne sont ni assez éclairés, ni assez puissants pour décider laquelle des deux causes est la plus juste; (4) que les chefs de ces partis, Cn. Pompée et C. César, sont l'un et l'autre les patrons de leur ville; que l'un leur a publiquement accordé les terres des Volques Arécomiques et des Helviens; et que l'autre, après avoir soumis les Gaules (Salyens ?), a aussi augmenté leur territoire et leurs revenus.
(5) En conséquence ils doivent pour des services égaux témoigner une reconnaissance égale, ne servir aucun des deux contre l'autre, ne recevoir ni l'un ni l'autre dans leur ville et dans leurs ports. De ce témoignage de César, on comprend que Pompée, au nom du Sénat et du peuple romain (publice), a concédé aux Marseillais des agri des Volques Arécomiques et des Helviens. Le texte dit condédé (concesserit) et non pas attribué. Comme Marseille est une cité fédérée, il n’y a pas lieu de penser à une attribution, mais bien à une concession de portions de territoires : en effet, l’attribution de tout ou partie d’un territoire à une cité est souvent une opportunité pour diffuser le droit latin, ce qui se concevrait avec un oppidum latin ou une colonie latine (Nîmes par exemple, à laquelle 24 oppida ignobilia sont attribués), mais n’a pas de sens avec une cité fédérée comme Marseille, ayant son autonomie politique et son propre droit. [NB - On apprend également que César, à la suite de sa victoire sur les Sallyas (une corruption pour les Gaulois ? les Salyens ?), a attribué des vectigalia à Marseille.le mot attribuere est employé et c’est bien une attribution de revenus fiscaux d’une cité à une autre cité. S’il s’agit bien des Gaules, l’attribution date de la fin des années 50]. 3 - Enfin des cités anciennement vaincues qui sont astreintes à fournir des cavaliers, de l’argent et du blé. Parmi ces cités anciennement vaincues, il faut mettre les Ligures (victoire de M. Fulvius Flaccus en 124), les Saluvii ou Salyens (Sextius Calvinus en 122), les Allobroges (victoires de Cn. Domitius Ahenobarbus et Q. Fabius Maximus en 121). Il s’agit donc de peuples entrés dans la soumission à Rome et qui sont tributaires. Les soutiens de Fonteius Face à cette série de peuples vaincus, Cicéron désigne les soutiens de Fonteius, Romains ou alliés de Rome. 1
. Les colons de Narbonne. Depuis 118 av. J.-C., Narbonne est une colonie romaine fondée dans la foulée du programme gracchien. Fonteius a sauvé la colonie ; : Propugnat pariter pro salute M. Fontei Narbonensis colonia, quae hunc ipsa nuper obsidione hostium liberata, nunc eiusdem miseriis ac periculis commouetur. « Parmi les défenseurs de M. Fonteius, on trouve encore la cité de Narbonne ; récemment délivrée par lui des ennemis qui la menaçaient de près, elle se montre aujourd’hui touchée de son infortune et de ses périls ». On sait qu’il s’agit de la menace que les Volques faisaient peser sur la colonie romaine. Malgré l’emploi du terme obsidio, qui signifie siège, on pense généralement que Fonteius a écarté la menace en s’en prenant aux Volques, mais sans qu’il y ait eu de siège effectif.. 2.
La cité de Marseille. Elle est l’illustration même de ce qu’est une cité fédérée, alliée de Rome. Ayant passé un traité avec le Sénat, elle est préservée dans son intégrité territoriale ; elle est protégée par Rome qui vient à son secours en cas de conflit ; elle reçoit même des terres et des revenus qui lui sont concédés ou attribués (voir ci-dessus) ; mais elle doit, en retour, une contribution à l’effort de guerre de Rome, en troupes et en navires (V-13). Son intérêt dans l’affaire de Fonteius est direct : pour elle, une sentence favorable aux Gaulois, viendrait fragiliser les concessions de terres dont elle a bénéficié sous Pompée. 3. Les Romains présents en Gaule transalpine pour raison économique.De nombreux citoyens romains sont présents en Gaule transalpine pour y faire des affaires, mettre en culture, pratiquer l’élevage ou gérer des revenus fiscaux. Il les nomme: publicani (publicains, collecteurs des impôts affermés), agricolae (agriculteurs), pecuarii (propriétaires-éleveurs), negociatores (négociants, commerçants). L’action du préteur consiste, parmi d’autres, à protéger leurs intérêts, probablement parce qu’il en retire lui-même avantage.
Pour illustrer la présence de ces Romains en Gaule méridionale, on doit rappeler le cas du procès à l’occasion duquel Cicéron, en 81 avant J.-C., avait défendu un héritier et prononcé le Pro Quinctio. Une societas de chevaliers romains possédait en Gaule méridionale des esclaves (servi), des terres (agri) et des pâturages (saltus). Cicéron défendit alors l’héritier d’un des fondateurs, à la suite d’une mésentente et des pratiques douteuses de l’autre associé.
Fonteiuus fut il condamné? il est propable que non;quoiqu'il en soit les plaintes que les Gaulois renouvellent quelques années plus tard demeurent san écho.
La Gaule méridionale accueillera César et restera fidèle à Rome durant toute la campagne contre les Gaules.
César en Gaulle.
La conquête de la Gaule interieure appelée quelque fois par les Romains "Gaule Chevelue"à commençé en 58 av J.C sous la direction du jeune général Caius Julius Caesar :Jules César.
Cette entreprise revêt pour celui ci une importance capitale: elle doit en effet lui permettre d'une part de s'affirmer comme un grand chef de guerre face à son rival Pompée, et ,d'autre part de se pourvoir en butin et en soldats,afin d'acceder à Rome au pouvoir suprême.
Aprés l'exercice du Consulat en 59 av J.C, il obtient le gouvernement des trois Provinces: La Dalmatie, la Gaule Cisalpine, et la Gaule Transalpine;toute trois zones de repli et de réserves militaires indispensable à la réalisation de son projet.
La situation en Gaule
A l'arrivée de Jules César la situation apparaît confuse;les Celtes loin d'être unifiés,sont répartis en trois grands ensembles au sein desquels les conflits sont fréquents.On distingue:les Aquitains dans le Sud-Ouest;les Belges qui dans le Nord Est constituent une forte confédération;et les Celtes proprement dit dans le Centre du pays.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k114566d/f36.item.r=nicolas+perrot+d'ablancourt.langFR.zoom
Ajouter un commentaire